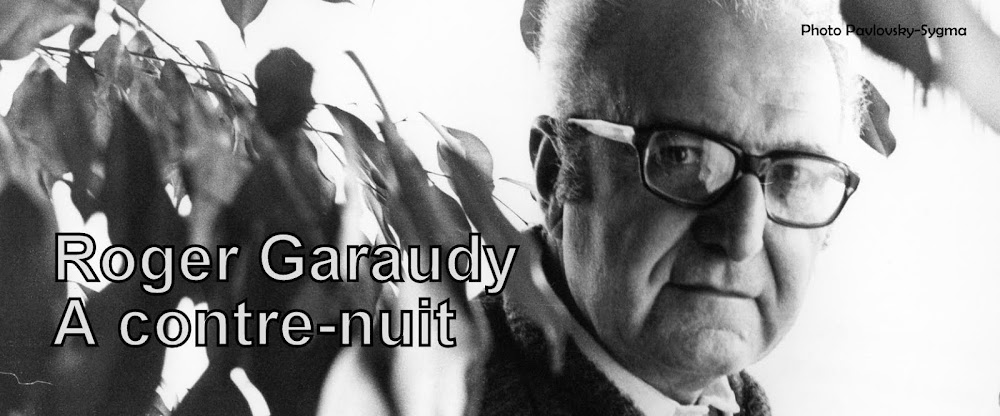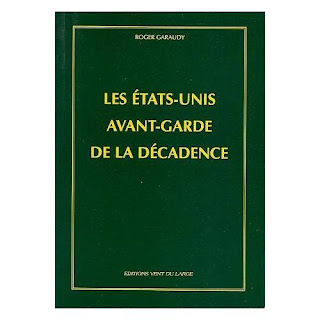Pour comprendre comment, aujourd'hui, la désintégration des mœurs et des arts a pour l'une de ses causes essentielles la diffusion (et les illusions) du «mode de vie américain », il est nécessaire de situer le problème dans la perspective de l'histoire américaine, car la décadence de la culture, ne jouant aucun rôle régulateur dans la vie de la société, découle de la formation et de l'histoire des États-Unis.
En Europe, la culture et les idéologies ont toujours joué un rôle important dans la vie politique, qu'il s'agisse par exemple de l'Europe de la Chrétienté, de l'âge des Lumières et de la Révolution française, du siècle des nationalités - et des nationalismes - ou du marxisme et de la Révolution d'octobre.
En Amérique, en dehors des autochtones indiens dont la haute culture régulait les relations sociales (comme chez les Incas), mais qui ont été décimés à 80 % par le grand génocide, refoulés, marginalisés et finalement parqués dans les réserves, tous les hommes qui peuplent aujourd'hui les États-Unis sont des immigrants.
Quelles que soient leur origine et leur culture première, ils sont venus essentiellement pour chercher du travail et gagner de l'argent. Irlandais ou Italiens, esclaves noirs déportés aux Amériques, Mexicains ou Portoricains, ils avaient chacun leur religion et leur culture; mais pas une religion et une culture communes. Le seul lien qui les rassemble est analogue à celui qui lie le personnel d'une même entreprise.
Les États-Unis sont une organisation de production régulée par la seule « rationalité» technologique ou commerciale, à laquelle on participe comme producteur ou consommateur, avec pour seule fin un accroissement quantitatif du bien-être. Toute identité personnelle, culturelle, spirituelle ou religieuse est considérée comme une affaire privée, strictement individuelle, qui n'intervient pas dans le fonctionnement du système.
A partir de telles structures sociales, la foi, la foi en un sens de la vie, ne peut vivre que dans quelques communautés qui ont gardé l'identité de leur culture ancienne, ou chez quelques individus héroïques. Dans l'immense majorité de ce peuple, Dieu est mort, parce que l'homme y a été mutilé de sa dimension divine: la quête du sens. La place est alors libre pour le pullulement des sectes et des superstitions, les évasions de la drogue ou du petit écran, le tout recouvert d'un puritanisme officiel qui s'accommode de toutes les inégalités et de tous les massacres, et leur sert même de justification.
(pp. 21-22)
(pp. 21-22)
La violence la plus sanglante et sa caution par une religiosité hypocrite est un trait permanent de l'histoire des États-Unis, depuis leur origine. Les premiers puritains anglais qui débarquèrent en Amérique y apportaient la croyance la plus meurtrière pour l'histoire de l'humanité: celle de « peuple élu », légitimant, comme des « ordres de DIEU », les exterminations et les vols de la terre des autochtones selon le modèle du livre biblique de Josué, où le « DIEU des armées» donne à « son» peuple la mission de massacrer les premiers habitants de Canaan et de s'emparer de leur terre.
De même que les Espagnols avaient appelé « évangélisation» le génocide des Indiens du sud du continent, les puritains anglais invoquèrent, pour justifier leur chasse aux Indiens et le vol de leur terre, le livre de Josué et les «exterminations sacrées» (herem) de l'Ancien Testament. « Il est évident, écrit l'un d'eux, que DIEU appelle les colons à la guerre. Les Indiens se fient à leur nombre, à leurs armes, aux occasions de faire le mal, comme probablement les anciennes tribus des Amalécites et des Philistins qui se liguèrent avec d'autres contre Israël. » (Truman Nelson: « The Puritans of Massachussets : From Egypt to the Promised Land. Judaïsm. » Vol. XVI, n° 2. 1967.)
(p. 23)
(p. 23)
Les États-Unis sortirent de la guerre dans une position de domination totale, une position sans parallèles historiques. Leurs rivaux industriels avaient été détruits ou sérieusement affaiblis, alors que leur production industrielle avait presque quadruplé durant les années de guerre.
Les États-Unis possédaient, à la fin de la guerre, la moitié de la richesse mondiale, alors que leurs pertes humaines étaient dérisoires comparées à celles du reste du monde. Cette guerre avait coûté à l'Allemagne plus de 7 millions et demi de morts (dont la moitié de civils), à la Russie plus de 17 millions de morts (dont 10 millions de civils), à l'Angleterre et à la France un million de morts, dont 450 000 civils, aux États-Unis 280 000 soldats (l'équivalent des morts par accidents d'automobiles aux États-Unis pendant la durée de la guerre).
(p. 33)
(p. 33)
Le« nouvel ordre mondial» rêvé par les dirigeants américains est un autre nom pour la domination mondiale des États-Unis.
Le « droit d'ingérence» est le nouveau nom du colonialisme.
Débarrassées du contrepoids de l'Union Soviétique (bradée par les dirigeants russes et désintégrée par les nationalismes), les Nations Unies, composées désormais des États-Unis, de leurs débiteurs et de leurs clients, deviennent une chambre d'enregistrement des volontés américaines pour leur servir de couverture et d'alibi.
La gigantesque machine militaire américaine, constituée au temps de l'affrontement Est-Ouest, devenait disponible pour d'autres tâches.
L'Europe ne pouvait être une rivale mais une vassale. Le traité de Maastricht dit explicitement, à trois reprises qu'il s'agit d'en faire :"le pilier européen de l'Alliance atlantique".
(pp. 74-75)
(pp. 74-75)
Ce cauchemar n'est pas seulement dans le gouffre de nos écrans, mais au cœur même de nos vies et c'est à ce niveau aussi qu'il faut le combattre; la politique ne devenant alors que l'extérieur de l'intériorité des arts et de la foi.
La prétention à la domination mondiale des États-Unis est devenue si évidente (par le délabrement de la vie qu'ils prétendent exporter et imposer au monde entier), qu'elle soulève des colères à l'échelle universelle. L'Europe même, partageant pourtant les privilèges de l'Occident, commence à s'éveiller de la longue torpeur qui l'empêchait de prendre conscience qu'elle est en train d'être dépendante sinon colonisée.
(p. 149)
(p. 149)